Le paradoxe de la violence – Notre société est-elle trop violente… ou pas assez ?
En matière de violence, l’esprit considère généralement que le moins est mieux que le plus. Cette conception binaire replie la réflexion sur elle-même. L’esprit fonctionne alors en vase clos et se trouve confronté à des paradoxes a priori insoluble. Quels sont ces paradoxes et comment voir au-delà ? La réponse qui sera étudiée ici est celle qui vient spontanément à l’esprit… avant d’être aussitôt refoulée : briser le vase !
 |
| Couvrez ce sein que je ne saurais voir ! |
Le premier paradoxe
La violence se combat par la violence.
Ainsi, tout le monde comprend et respecte les assassinats perpétrés par les résistants français pendant la Seconde Guerre Mondiale, mais personne ne justifie les exactions terroristes contemporaines. Si on prend une période entre les deux comme celle de la guerre d’Algérie, chacun appréciera en fonction de sa morale l’usage de la torture. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles ? En fait, plus la violence est proche de nous, plus elle nous touche de manière subjective, c’est-à-dire en tant que sujet. C’est cette subjectivité qui se trouve révélé dans l’emploi du terme « Je suis Charlie » et ses dérivés. La solidarité ou les condoléances ne suffisent plus : il faut fusionner avec la victime.
La violence subjective exerce sur nous une fascination hypnotique. Lorsque nous en sommes témoins plus rien d’autre n’existe. De plus en plus régulièrement elle envahit nos écrans. Récemment un producteur tabassé par la police, mais la semaine avant c’était une autre affaire et l’on peut remonter loin ainsi. Parfois ce sont des violences policières, parfois ce sont les policiers qui en sont victimes, parfois encore ce sont des citoyens entre eux, cela est devenu de plus en plus continu au fil des années. Jusqu’à en devenir banal.
Parce qu’elle est subjective, cette violence ne peut pas être pensée. Ou plutôt : la subjectivité constitue une forme de réflexion a priori, qui bloque toute possibilité de communication : si je m’identifie au sujet victime de blasphème, comment dialoguer avec ceux qui s’identifient au sujet décapité ? C’est le même problème que rencontrera une victime de viol : s’est-elle véritablement faite violer ? Là c’est ce qu’elle dit, mais ne l’aurait-elle pas un peu cherché ? Que faisait-elle, habillée comme une salope avec ses yeux qui crient braguette et un cul de chasseuse de bite intergalactique, dans un quartier craignos, sinon tenter le diable ?
Le deuxième paradoxe
Notons que si notre société est de plus en plus violente, tout a pourtant été tenté pour évacuer toute forme d’oppression. Les handicapés ne sont plus des handicapés, ce sont des personnes “en situation“ de handicap. Les paralytiques sont désormais « à mobilité réduite » et les aveugles « mal-voyants ». Les balayeurs ne sont plus des balayeurs, ce sont des techniciens. Les personnes non-binaire qui souffraient tant par le passé de devoir cocher « Homme » ou « Femme » sur les questionnaires peuvent maintenant choisir « Autre ». Nous avons même réussi, par le biais de l’écriture inclusive, à nous racheter de deux millénaires d’oppression patriarcale que l’homme blanc faisait subir à l’autre moitié de l’humanité : la femme noire.
Quoiqu’il en soit, on peut bien dire que tout a été fait pour expurger notre langage de toute forme de violence. Exit les pédés, bougnoules et autres enculés, la chasse à la grossophobie, à la xénophobie, au sexisme, âgisme, validisme et à toute les formes d’expression de l’intolérance est ouverte. Récemment, « Les dix petits nègres » d’Agatha Christie a même été réécrit afin d’être expurgé de certains mots jugés trop violent pour le lecteur contemporain. Le livre s’appelle désormais « Ils étaient dix ».
N’est-il pas paradoxal qu’alors même que la société semble se soucier comme jamais dans son histoire de n’oppresser personne, alors même que les préoccupations actuelles du pouvoir – l’écologie, la sécurité, la santé, la liberté d’expression – semblent tout ce qu’il y a de plus légitime, n’est-il pas paradoxal de constater un tel niveau de violence ?
Un sociologue répondrait sans doutes que la violence subjective n’est que l’expression de la violence objective : celle du système. Ce serait alors une certaine forme de prédétermination sociale qui transformerait les individus en flic ou voleur.
L’erreur serait d’opposer à la prédétermination, le libre-arbitre : quoique déterminés, les individus demeurent libres ; quoique libres, ils restent sous influence. La violence subjective n’est jamais que la violence objective passée à travers le prisme de notre perception puis du langage. La langue exprime la dernière forme de violence : la violence symbolique.
Ce qui est combattu dans notre société, ce n’est pas la violence subjective : c’est la violence symbolique. Et la violence symbolique est combattue au motif de la violence subjective, ce qui permet in fine de ne pas questionner la violence objective, c’est-à-dire le fonctionnement du système.
Prenons un cas concret. La photo d’un gilet jaune édenté peut nous toucher subjectivement. Mais le gouvernement se défendra de cette violence en la justifiant par la violence plus grande encore qu’il y aurait dans le cas où la police n’interviendrait pas. Les « black blocks », les « casseurs », les « extrémistes », les « radicalisés » : la violence subjective est étouffée sous la symbolique véhiculée par le vocabulaire. Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’un jeune français d’une vingtaine d’années qui vient de perdre ses dents, un œil ou une main. Cette information s’inscrit dans un ordre symbolique plus grand, où la République éternelle mène l’avant-garde du combat pour le salut de l’humanité contre les ténèbres qui la guettent.
Nous l’avons dit, ce détournement depuis le symbolique jusqu’au subjectif refoule la violence objective, celle qui relève du fonctionnement systémique. La distance entre la violence symbolique et la violence subjective est une bonne mesure de ce qu’on appelle le fascisme. Le fascisme n’est pas une forme de gouvernement ni une idéologie spécifique : c’est la distance entre la violence qu’on voit et la violence qu’on évoque ; qui sert à masquer la violence qu’on n’évoque pas.
C’est notre troisième paradoxe.
Le troisième paradoxe
Bonnes fêtes à tou·te·s ! Quand j’étais petit on disait « Joyeux Noël ! », mais Noël, fête chrétienne, a été jugé trop violent comme mot ; le terme « fêtes » au pluriel lui a été préféré, qui avait en outre le mérite d’inclure le premier de l’an. Puis l’écriture inclusive est arrivée, avec le point·médian, qui avait le dessein d’androgyniser les mots pour enfin abolir cette règle grammaticale d’une insoutenable violence, celle de l’emploi du masculin·neutre au pluriel. Récemment certains maires ont souhaité rompre avec la tradition d’exhiber des arbres morts sur les places publiques, rite païen jugé là encore trop barbare. Les années d’avant, ce sont les crèches qui ont été retirées des lieux publics : trop oppressif pour les agnostiques ou les mécréants.
Le paradoxe, c’est que ce soucis constant de ne pas être violent constitue une violence en soi. Ainsi, à la violence du mort·selles·ment linguistique, il faut ajouter la distance entre ce qui est perçu et ce qui est dit : ça tabasse, ça pille et ça viole à tous les coins de rue, mais la priorité semble être l’enculage de mouches sur les règles de grammaire ou la décoration des mairies.
Ce troisième paradoxe est aussi vieux que le monde : Si vis pacem, para bellum. L’état de paix ne peut être préservé que dans le mouvement constant vers la guerre. C’est ce que Louis XIV avait fait gravé sur ses canons : Ultima ratio regum. La violence est le dernier argument des rois. Le peuple est-il bien roi en démocratie ?
Mais comment se résoudre à l’agressivité contre quelqu’un qui défend nos idées ? N’est-il pas nécessaire de lutter contre la pollution, contre les virus, contre le terrorisme ? S’il y a au cours de cette lutte un accroissement des attentats, des contaminations ou de la pollution, n’est-ce pas là une forme d’incompétence anecdotique ? Certes, il y a eu des incompréhensions, des erreurs, des maladresses ; mais le fond est bon n’est-ce pas ?
Quelle chance tout de même, en effet ! Nous avons là un président jeune, beau, dynamique, avec des idées et des projets ; un pays pleins de rêves, la start-up nation ! Il a des valeurs, est soucieux du futur, il s’intéresse à la sécurité de chacun, il voudrait que tout le monde soit riche et trouve du travail.
Le fascisme, c’est la distance qu’on mesure entre l’ordre objectif et l’ordre symbolique : entre les faits et leur explication. Pourquoi le couvre-feu ? Pour nous protéger du virus. Le fascisme, c'est le cheminement mental qui va du virus au couvre-feu et qui oblitère tout le reste. Après tout, les français ne sont-ils pas indisciplinés ? Si ils ne suivent pas les consignes c'est parce qu'ils ont besoin d'autorité. S'ils les suivent, ce n'est jamais assez ; alors on interdit, on oblige, on édicte, on réglemente, on contrôle ; on punit.
Dans une véritable dictature, le gouvernement aurait pris sur lui d’instaurer le couvre-feu ou l’internement d’opposants. Ça aurait été le fait du prince. Ce qui caractérise une dictature de fasciste, c’est que la violence objective n’est pas assumée, mais refoulée à travers le langage, sur des pulsions a priori « saines ». On dirait une sorte de chantage affectif : si tu veux que mami survive, tu restes chez toi ; ou encore, si tu n’avait pas pourris la planète comme un gros enculé depuis cent cinquante ans, il n’y aurait pas autant d’immigrés climatique aujourd’hui, donc arrête de te plaindre.
La violence policière repose sur le double-chantage suivant : si vous voulez que la police continue de vous protéger contre les hordes de terroristes sanguinaires, il faut accepter qu’elle vous frappe. Pour le policier, le problème est à peu près le même : si vous ne voulez pas abandonner la nation au chaos, il faut accepter de frapper les manifestants. Ce chantage permanent s'exprime là encore sous forme de paradoxe : pour empêcher le pire, il faut le commettre.
In fine, nous avons deux citoyens qui se battent l’un contre l’autre, non pas parce qu’ils sont en désaccords, mais parce qu’à l’intérieur du vase clos de notre système, ils sont devenus les sujets de la violence objective. Le manifestant éborgné ne l’a-t-il pas un peu cherché après tout ? Si vous allez parader en uniforme fluo pour narguer des types armés, la probabilité de se faire tirer dessus n'est pas négigeable. De même, la petite étudiante violenté dans une cave sordide n'a-t-elle pas provoqué son malheur ? Si vous vous exhibez en tenue affriolante devant des lascars drogués qui ne pensent qu’avec leur bite et leur couteau, le viol est – comme la perte d’un membre pour le manifestant – de l'ordre du naturel. Staline disait "La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million est une statistique." À plus de deux cents viols par jour, ne pourrait-on pas dire que c'est un problème statistique ? Car enfin, on ne peut pas passer son temps à pleurer sur tous les malheurs du monde ! Des règles telles que "je suis une femme donc je ne sors pas seule" ou "je suis un manifestant donc je me fais tabasser" deviennent ainsi progressivement aussi naturelles que la règle de la gravité.
Il y a la violence qu’on cache. Celle que l’on refoule et qui, à travers ce processus de refoulement prend une place centrale dans le propos. Avant « tou·te·s », personne ne considérait offensant d’écrire « tous ». L’offense vient en même temps que le refoulement ; elle est le refoulement.
Et il y a la violence qu’on ne montre pas. Contrairement à la violence qu’on cache et qui se trouve mise en avant, la violence qu’on ne montre pas disparaît. Nous ne possédons même pas de mots pour l’exprimer.
Qui est-il cet énergumène ? Ce petit con, ce gros enculé, ce Jean-foutre ?! Même en faisant un détour par les insultes, il est impossible d’exprimer avec justesse la violence ressentis lorsqu’un minable fonctionnaire casqué prend prétexte de son statut pour se permettre de nous dicter quoi faire de notre temps libre. Les policiers intègres ne s’y trompent pas : soit ils démissionnent, soit ils se suicident. Restent les autres, sur les boulevards. Ils errent sans but, flashant machinalement des téléphones et fouillant sans convictions des sacs à mains. Véritables zombies masqués, ils quémandent le respect et s’insurgent quand on les traite de nazi. Bravo les gars, vous faites un travail formidable ! On ne pourrait rêver d’une meilleure police. Vous êtes le fleuron de la nation et l’exemple pour notre jeunesse. Vous êtes la fierté du pays !
Le langage trahit ce qu’il occulte : prononcer exactement les paroles que les policiers aimeraient entendre fait immédiatement apparaître, par leur incongruité, une dimension cynique dans le propos. Eux-même ne s’y trompent pas, qui le dénoncent à travers la voix de certains syndicalistes. Quand il y a des manifestations toutes les semaines pendant des mois, qu’il y a régulièrement des blessés graves et que l’approche politique sur ces évènements consiste à acheter des flash ball, la violence n’est plus appréhendée comme un accident du système. Mais comme son fondement.
Libérons la violence !
Ce sera notre dernier paradoxe, qui n’est jamais que l’inversion du précédent : c’est le refoulement de la violence qui est la violence ; c’est donc l’expression de la violence qui constitue le chemin vers l’apaisement.
En un sens, c’est logique. Freud avait déjà pointé du doigt la dimension énergétique de l’inconscient. L’inconscient est un langage, c’est un automatisme, c’est une structure, mais c’est aussi et surtout de l’énergie. Nos pulsions constituent le matériel brut de cette énergie. Ces pulsions sont transformées par un constant mouvement de flux et de reflux jusqu’à la conscience, sous forme d’actions. Les conceptions plus récentes d'Ernest Rossi présentent l’être humain comme un ensemble complexe de systèmes interconnectés entre eux et avec l’extérieur. À côté du système nerveux, du système digestif ou musculaire, il y aussi le système des croyances, des valeurs, etc. Le monde, depuis l’ADN jusqu’au cosmos, peut-être interprété en terme de systèmes reliés les uns aux autres.
Ce qu’il appelle la transduction d’information, c’est le phénomène par lequel une information change en passant d’un système à un autre. C’est en fait la base de l’hypnose : comment est-ce qu’on passe de la voix aux phénomènes ? Quel chemin y a-t-il entre la suggestion « la douleur disparaît » et la disparition effective de la douleur ? Comment passe-t-on de la pulsion à l’action ? Via la transduction d’information.
Ce concept nous dit peu du comment, son attrait essentiel est d’exister et de présenter à l’esprit la possibilité d’imaginer un certain type générique de communication entre des systèmes a priori fort distinct.
Je vais vous proposer une expérience grandeur nature du phénomène de transduction. Prenez une douche froide et chronométrez-vous. Combien de temps tenez-vous ? Faites l'expérience en restant silencieux et en hurlant, jurant, ou chantant. Vous allez tenir vingt à trente pour cent de temps en plus.
Par quel miracle ? L’eau froide provoque une réaction physiologique de stress. L'expression symbolique de cette violence évacue le stress, ce qui augmente la résistance physique.
S’il est possible de contrôler le corps par l’esprit, l’inverse est également vrai : en témoignent les nombreuses techniques de respiration qui ont été développées suite à l’interdiction du LSD pour la thérapie ; le rebirthing par exemple. Simplement en respirant de manière spéciale pendant une vingtaine de minutes, il est possible de provoquer des sensations durables et profondes d’euphorie.
Oui, mais la violence dans tout ça ?
La première soupape de la violence, c’est son expression verbale. « Cette fois encore la police est l’ennemie (…) ça sent l’émeute, la foule crie vengeance (…) Les plus jeune m’écoutent dans l’école de la rue, Premier cours : lancer le cocktail molotov (…) Pas de paix sans que le poulet repose en paix (...) le message est passé : je dois sacrifier un poulet. »
Le point que je souhaiterais mettre en avant, est que cette violence est non seulement inévitable, mais aussi utile. Ce n’est pas nouveau, Brassens déjà se réjouissait dans la chanson Hécatombe, du malheur fictif d’une bande de policiers pris à partis dans un marché populaire. Quoique la violence du propos soit légèrement atténuée par la poésie de l’auteur, il n’en demeure que les supplices des malheureux sont évoqués avec un plaisir gourmand, depuis le tabassage à grands coups de mamelles jusqu’à la tentative d’émasculation avortée car, semblerait-il, ces policiers là n’avaient pas de couilles.
Nos policiers qui jouent les gros bras avec des collégiens et qui baissent les yeux en banlieue ont-ils pareillement des couilles, pourrait-on se demander ? Hélas on ne le peut pas car aussitôt on serait accusé d’outrage à agent. Sortir le calepin à contravention alors qu’on demandait de sortir ses couilles, n’est-ce pas là une réponse éloquente en soi ?
Mais comment un brave policier, avec des testicules bien accrochées et reliées à un cœur en état normal de fonctionnement pourrait-il survivre aujourd’hui en France ? Il y a des fois où la folie peut être un signe de santé mentale. Imaginez, vous contactez la paroisse du coin en proposant votre aide pour donner la soupe aux malheureux, et vous vous retrouvez invités à un gang bang sado-maso dans les caves du presbytère. Vous vous diriez sans doutes « il doit y avoir un malentendus ».
Le même genre de malentendus qui fait qu’un militaire qui s’engage pour servir la France se retrouve six mois plus tard à patrouiller en uniforme dans un supermarché. Les malentendus qui font que le service public s’est transformé en vaste entreprise d’extorsion généralisée dont la police fait office de milice. Il n’y a jamais personne de disponible quand on souhaite dénoncer un crime, mais il y a toujours une bonne âme pour contrôler que le masque est effectivement porté au-dessus du nez et sanctionner le citoyen indiscipliné qui ne respecterait pas à la lettre le protocole.
Souvent quand des musiques particulièrement violentes sortent, certains commentateurs tournent en rond en se demandant sempiternellement « quelles sont les limites à la liberté d’expression ? » L’écueil qui les fait chavirer est celui du refoulement de la violence associée au refoulement de la violence de l’interdiction. C’est pas bien de dire ça, mais ce serait pire d’interdire de le dire. L’idéal serait donc que les gens soient libres de le dire… mais choisissent de ne pas le faire.
Coincé entre deux maux, la pensée binaire ne sait se projeter au-delà : pour éliminer toute violence, il faudrait d’abord que chacun se fasse violence en pacifiant son expression verbale.
Ce qui est bien évidemment faux, comme nous l’avons vu. Entre le réel symbolique et le réel subjectif, il y a le réel objectif. Notre rôle n’est pas de choisir de quel vase nous allons parler ni encore de débattre de sa superficie. Si ce vase nous enferme, ne faut-il pas tout simplement le briser ?
Notons que la licence artistique permet de dire à peu près tout et n’importe quoi. Dès qu’il est passé à travers le prisme de l’art, n’importe quel sujet devient beau. Ainsi, Vald étant avant tout un artiste, ce qu’il faut comprendre n’est évidemment pas un appel au meurtre… Encore que !
En effet, chacun est libre de comprendre ce qu’il veut dans l’art. C’est pour ça qu’on le sacralise en France ; pays de la liberté d’expression. Ainsi, si parmi tous les auditeurs de Vald il ne s’en trouvait qu’un seul – mais tout de même un – qui comprenne sa phrase au sens littéral, ne faudrait-il pas malgré tout interdire à l’artiste de chanter ? Si ça permettait de sauver une vie ?
Ce mode de raisonnement fonctionne ainsi que nous l’avons vu, en imposant sa subjectivité spécifique via le refoulement de la violence perçue, hors du langage. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir ! » Et comme nous l’avons vu, ce mouvement de l’esprit oblitère totalement la violence systémique du problème : si quelqu’un tire sur un ministre, ce n’est pas parce qu’il a entendu une chanson à la radio. Ce n’est pas interdire l’expression de la violence qui rendrait d’un coup de baguette magique la société plus pacifique. Interdire l’expression de la violence bloque simplement le processus de transduction depuis la pulsion jusqu’à son expression.
L’individu accumule donc de la violence en lui, sans pouvoir l’évacuer ; jusqu’à l’explosion finale. L’expression « déséquilibré » trahit, par la généralisation de son emploi, sa dimension systémique. De la même manière que la société fabrique un taux naturel de suicide – c’est ce que Durkheim a montré à la fin du XIXe siècle – notre système actuel fabrique de plus en plus de déséquilibrés.
Quand on s’en prend à certains rappeurs qui auraient la haine de la France, on fait d’abord l’erreur de nier la dimension symbolique de leur propos. Un meurtre symbolique est déjà un meurtre pour l’esprit. Il se suffit à lui-même. Quand Disiz chante « J’pète les plombs, putain, j’pète les plombs ! » le langage est l’expression de ce pétage de plomb. À la fin de la chanson, c’est fini. Dire « je pète les plombs » est paradoxalement le moyen de ne pas le faire.
On fait ensuite l’erreur de nier la violence de leur propos. Soit le propos est réel et c’est très violent, soit c’est de l’art et ce n’est pas sérieux. En vérité, c’est très sérieux, très réel et très violent… mais c’est aussi de l’art. C’est un meurtre sans victime mais qu’on aurait tort de considérer comme non-violent. « Justice nique ta mère ! (…) Assassin de la police ! (…) Non, rien de rien, non, je ne regrette rien… Nique la police ! »
Cette violence est réelle et c’est parce qu’elle est réelle qu’elle est précieuse, puisqu’elle participe de cette transduction d’information qu’on appelle le processus cathartique. Elle constitue une soupape en même temps qu’un indicateur : voilà où nous en sommes. La libre-expression symbolique de la violence subjective, via le langage, permet à l’individu de maintenir une certaine forme d’équilibre psychologique lorsqu’il est confronté à la violence objective. Sans cet équilibre, c’est le chaos.
Je crois hélas qu’en matière d’expression, nos libertés ont drastiquement réduit ces derniers temps. La gérante d’un Escape Game à Toulouse a ainsi été amenée en garde à vue parce qu’elle offrait la possibilité dans un des scénarios de son établissement, de tuer le président au moyen de cocktail molotov fait d’une étoffe de gilet jaune. La dimension symbolique du message est pourtant évidente, mais la dame a été harcelée et menacée jusqu’à ce qu’elle change le scénario. Désormais, il faut sauver le président. On aurait tort de nier la violence du message en prétendant que ce n’est qu’un jeu. Tuer le président, même dans un jeu, n’a rien d’anecdotique. Mais si le président est vraiment libéral, il devrait comprendre : le marché a perçu une demande du public et a présenté une offre en conséquence. La violence, ce n’est pas qu’on puisse tuer le président, c’est qu’on le veuille.
Pour apprécier la valeur de la violence, il convient d'apprécier à sa juste valeur celle de la non-violence. Gandhi explique ainsi : "S'il fallait absolument faire un choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. (...) Je suis d'avis que ceux qui croient à la violence apprennent le maniement des armes. Je préfèrerais assurément que l'Inde eût recours aux armes pour défendre son honneur plutôt que de la voir devenir ou rester lâchement l'impuissant témoin de son déshonneur. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence : pardonner est plus viril que punir. (...) Mais s'abstenir n'est pardonner que s'il y a la possibilité de punir : l'abstention n'a aucun sens si elle provient de l'impuissance. On ne peut guère dire que la souris pardonne au chat lorsqu'elle se laisse croquer par lui."
Comme nous sommes conditionnés à la refouler, annoncer de but en blanc que la violence ne constitue pas un problème mais la solution aurait sans doutes été un peu abrupt. Il fallait d’abord se familiariser avec les notions de subjectivité, d’objectivité et de symbolique afin d’affiner notre compréhension. Après avoir abordé la violence par la face paradoxale, nous approfondirons dans un prochain article ses vertus.
Le fascisme s’installe, pourrions-nous dire, sur un malentendus. Un matin on apprend qu’il faut rester chez soi, qu’on n’a plus le droit de travailler ni de voir sa famille ou ses amis. On apprends qu’il y a un couvre-feu, que les livres sont interdits à la vente. Soudain, les médecins qui disent « le masque ne sert à rien » ne sont plus aussi crédibles que les policiers qui expliquent le contraire. Ceux qui ne sont pas d’accord se font tabasser, gazer en manifestation ou même internés en asile psychiatrique. Surtout pas de panique, la situation sanitaire est sous contrôle !
La fascisme s’installe en catimini car la violence qu’il provoque n’est pas directement perçue comme une violence, mais comme une incompétence. En manipulant le langage symbolique, l’État fasciste donnera la sensation d’être continuellement à côté de la plaque, mais sur la bonne voie malgré tout. Ainsi, le fascisme ne peut pas se concevoir comme une forme du gouvernement, mais comme la distance entre le réel subjectif et le réel symbolique. Symboliquement, nous luttons contre le virus. Mais si vous avez plus peur de l’État que du virus, alors sans doutes pouvez-vous considérer que vous vivez dans un État fasciste.


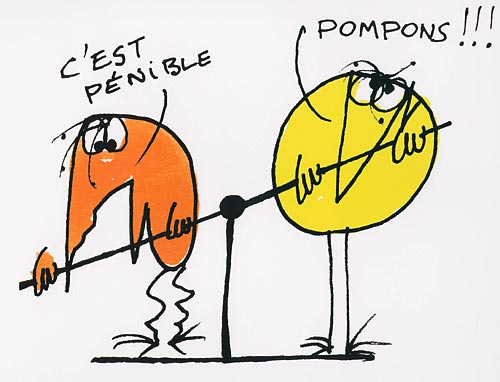
Commentaires
Enregistrer un commentaire